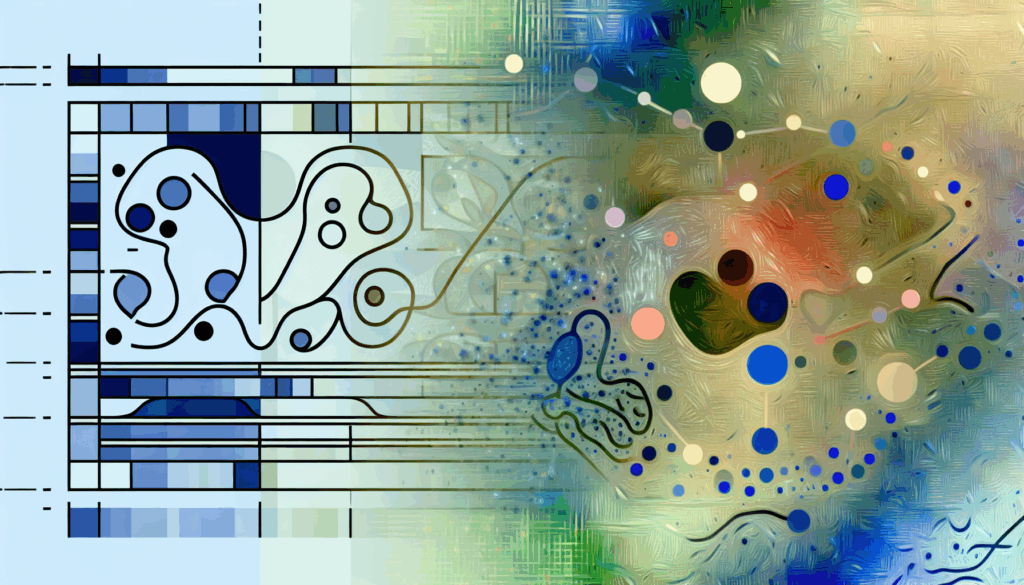Introduction à la découverte microbienne
Des chercheurs ont identifié un microbe intestinal humain capable de renforcer l’efficacité de certains médicaments anticancéreux chez les souris. Cette découverte prometteuse ouvre la voie à un essai clinique pour déterminer si ce microbe pourrait avoir le même effet chez l’homme. Le microbe en question stimule les cellules dendritiques du système immunitaire, qui amplifient ensuite les effets des médicaments anticancéreux en activant les défenses naturelles de l’organisme contre les tumeurs.
Un réservoir précieux de bactéries
Cette étude, publiée le 14 juillet dans la revue Nature, s’inscrit dans une série de recherches de plus en plus sophistiquées qui explorent la relation entre les microbes du corps humain et la réponse aux traitements contre le cancer. Marlies Meisel, spécialiste en immunologie et microbiologie à l’Université de Pittsburgh, souligne l’importance de cette découverte, qualifiant ces bactéries de « véritable mine d’or ».
Le rôle du Hominenteromicrobium mulieris
Jusqu’à présent, la bactérie Hominenteromicrobium mulieris était peu connue. Découverte il y a seulement trois ans, elle prospère discrètement dans l’environnement pauvre en oxygène et riche en nutriments de l’intestin humain. Hiroyoshi Nishikawa, immunologiste au Centre National du Cancer à Tokyo, et son équipe ont identifié une nouvelle souche de ce microbe en analysant des échantillons fécaux de 50 personnes atteintes de cancer, traitées avec des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire.
Comment les bactéries intestinales peuvent améliorer les traitements anticancéreux
Ces thérapies peuvent avoir des effets remarquables, permettant parfois au système immunitaire de maintenir des rémissions prolongées dans les cancers avancés. Cependant, elles ne fonctionnent que chez une fraction des patients. Les chercheurs cherchent donc à élargir l’efficacité de ces médicaments.
Pour comprendre pourquoi certains patients répondent aux inhibiteurs de point de contrôle et d’autres non, l’équipe de Nishikawa a utilisé les échantillons fécaux collectés pour les transplanter chez des souris atteintes de tumeurs. Les souris ayant reçu des transplantations de personnes ayant bien répondu au traitement ont montré une meilleure réponse que celles ayant reçu des transplantations de personnes n’ayant pas répondu.
Identification du microbe responsable
Nishikawa a entrepris de localiser le micro-organisme responsable de cette différence dans les transplantations fécales. Après un an et demi de recherches, l’équipe a identifié la souche de H. mulieris ayant le plus grand impact. « Je suis immunologiste, pas microbiologiste », explique-t-il. « Je ne savais pas que cela demanderait un tel effort. »
Le mécanisme d’action du H. mulieris
Avec ces informations, l’équipe a pu déterminer comment H. mulieris améliore la réponse aux inhibiteurs de point de contrôle. Chez les souris, ce microbe stimule les cellules dendritiques, qui peuvent se déplacer dans le sang jusqu’aux tumeurs. Là, elles activent une sous-population de cellules immunitaires, appelées cellules T, capables de reconnaître et de détruire les cellules cancéreuses. Cela renforce les effets des inhibiteurs de point de contrôle, qui agissent en libérant ces mêmes cellules T ciblant les tumeurs.
🔗 **Fuente:** https://www.nature.com/articles/d41586-025-02224-3